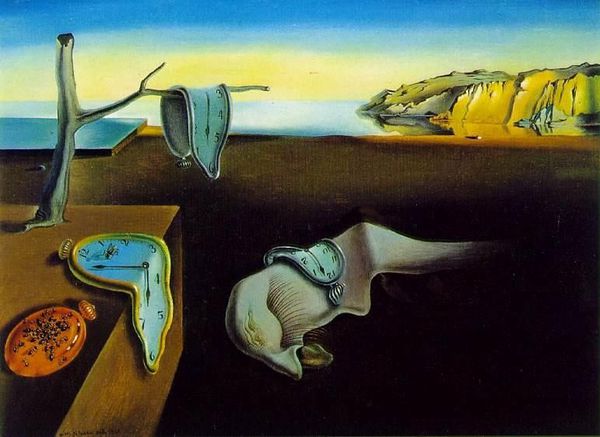Les fondements d’une tragédie épisode 2

C |
ommentant le procès d’Eichmann, le philosophe Moshe Habertal dit dans l’émission diffusé par la chaine histoire intitulé « Adolf Eichmann, une exécution en question » :
« Sa condamnation n’a pas de valeur symbolique. Elle en a une autre qui mérite qu’on s’y intéresse de plus près : Il y a quelque chose d’étrangement triomphant dans cette volonté de justice. On amène des nazis devant la justice. On en a attrapé un, Eichmann. On l’amène à Jérusalem et on voudrait montrer comment la justice travaille mais c’est ridicule. On parle de châtiment. Il y a six millions de morts et on attrape un seul nazi. Un grand criminel, certes, mais où est la justice là-dedans ?
…….
Je pense qu’au final, parce que ce procès a eu une conséquence inattendue et que personne n’avait envisagée de donner la parole aux survivants pour la première fois, Il en valait la peine, non parce qu’il a rendu la justice mais parce qu’il s’est trouvé être pour des raisons psychologiques et sociales compréhensibles la seule tribune où cette voix a commencé à être entendue.
Depuis le discours a complétement changé, de façon très importante, tout évènement politique a des conséquences imprévisibles. Ça, c’était une conséquence imprévisible qui fait que rétroactivement, ce procès en valait la peine pas dans le sens où il a rendu la justice mais il y a une forme de justice pour les victimes et les survivants, non en exécutant Eichmann, mais en leur permettant d’apparaitre devant la nation et de dire : « Voici notre histoire !»
Toute une génération d’Israéliens a été bouleversée par ça. Je viens d’une famille… Mon père était un survivant. À l’époque j’étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Mais c’est un fait. Toute une génération de survivants qui, jusque-là, était silencieuse a enfin pu s’exprimer.
Les Israéliens se sont autorisés à écouter cette voix parce qu’ils pouvaient l’écouter à partir d’une position de pouvoir.
La justice est, avant tout, une monopolisation de la vengeance. Un état ne peut tolérer que la vengeance soit une affaire privée parce que ça serait sans fin. Il choisit au contraire d’organiser la sanction.
Vengeance et justice ne sont pas très éloignées Parce que l’instinct de la justice, c’est le châtiment. Œil pour œil et l’état prend le contrôle et monopolise la vengeance est dit « ceci est la justice. »
Le 1er Juin 1962, dans une émission spéciale organisée à l’occasion de l’exécution d’Eichmann le professeur Hugo Bergmann s’exprimait d’une voix à la fois lasse et déterminée :
« J’ai l’impression qu’au sein du peuple d’Israël, il existe deux forces qui sont en conflit depuis des siècles. La première, je l’appellerai la haine d’Amalek. La seconde, je la qualifierai par ce précepte : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour moi, ce qui ressort de ce procès et qui me paraît primordial, c’est que la pétition qui a été remise au Président par un groupe d’intellectuels pour lui demander de ne pas exécuter Eichmann a été signée par Yehuda Bacon un rescapé d‘Auschwitz.
J’y vois la preuve de l’existence d’un courant juif qui, bien qu’ayant été vaincu cette fois, devra se battre pour conquérir sa place au sein du peuple d’Israël. »
Évoquant ce témoignage, Moshe Habertal, dit :
« Bergmann a défini la question d’une façon plus profonde. C’est lui qui, des trois, est allé le plus loin dans la réflexion. Il n’a pas voulu ramener la question entre les juifs et les allemands.
Pour lui, il s’agissait d’un problème interne au judaïsme. Il a vu dans l’histoire moderne juive émergente ce conflit qui est déjà présent à l’intérieur de la tradition.
Il y a deux voix qui coexistent. Elles ont chacune leur particularité.
La première dit : le souvenir de l’holocauste, comme tous les souvenirs de douleurs dans notre tradition, renvoie à la solidarité avec les victimes parce que nous avons été des victimes. Derrière il y a cette idée « souviens-toi de l’étranger car tu as été étranger en Égypte » ; C’est profondément ancré dans la tradition juive.
Et puis, il y a une autre voix qui dit non pas transforme ton souvenir en un acte de solidarité avec celui qui est vulnérable mais qui dit « souviens-toi afin de te venger ! »
C’est le commandement d’Amalek « N’oublie pas ce qu’ils t’ont fait ».
Et Bergmann pensait que le procès jouerait dans ce registre de la tradition et viendrait renforçait des tendances à l’intérieur d’une tradition déjà complexe et ambivalent, qu’il n’aimait pas et pour de bonne raisons...
Il pensait que c’était un message éducatif erroné sur qui nous sommes en tant que peuple, sur ce qu’est le judaïsme et la façon de le mettre en pratique dans nos vies politiquement. »
Depuis il semblerait que ces forces sont toujours en conflit mais que la voix d’Amalek a pris singulièrement le dessus aujourd’hui chez les dirigeants d’Israël.
Patrice Leterrier
21 mai 2018



/image%2F1573456%2F20150517%2Fob_c6e51e_loi-sur-le-renseignement.jpg)